MONSTRE(s)

I- Du cirque Barnum aux villages ethniques d'Hagenbeck.
En fouillant parmi les souvenirs de mon arrière-grand-père, j'ai été transporté des siècles auparavant. Et pourtant. Pourtant j'ai eu l'impression d'une époque entre parenthèses, dont les stigmates marquent encore nos sociétés actuelles. Quelle signification peut-on accorder à ces dizaines d'affiches, ces billets d'entrées, ces objets quotidiens d'une violence saisissante ? En cherchant à comprendre les origines de la déshumanisation de l'Autre, j'ai croisé les victimes et leurs bourreaux. Des collections de monstres à l'élaboration des zoos humains, des hommes de spectacle aux hommes d'affaires, j'ai voulu comprendre qui tirait les ficelles de ces « phénomènes » et ce que subissaient les pantins.
DES MAÎTRES...
Au fil de mes recherches, je découvre des personnages emblématiques d'une époque où malhonnêteté rime souvent avec gloire.
L'Américain Phinéas Taylor Barnum, dont la réputation ne tient souvent qu'à ses incommensurables mensonges, a su conquérir, de sa naissance en 1810 jusqu'à sa mort en 1891, le monde du show business. Dans chacun des articles que j'ai pu parcourir, des plus sceptiques aux plus admiratifs, j'ai senti combien cet homme fascinait les foules.
De sa première acquisition, « Joice Heth », en passant par le rachat du musée américain de Scudder à New York City en 1842 et ses nombreux scandales ( voir la sirène des îles Fidji), il clôt sa carrière en louant son nom à un cirque, en 1871, entreprise qui sera rachetée par ses collaborateurs à sa mort, pour devenir le cirque Barnum et Bailey, qui parcourt encore aujourd'hui le monde.
Pour revenir à notre sujet principal, qui est l'exploitation de l'insolite chez l'homme par les sociétés de cette époque, j'ai été frappé par ce personnage prêt à tout pour réussir. Dans les nombreux contrats qu'il a pu conclure, avec ces hommes et ces femmes, il n'a, bien entendu, jamais été question de leur offrir une chance de s'intégrer. Leur rôle était d'être exhibés, en parfaites curiosités, afin d'attirer le Tout New York et les foules plus ou moins intéressées. Était-ce pour rassurer une époque elle-même sur sa normalité ?
Quelle étrange conception de l'autre.
Ce qui est le plus fascinant, c'est cette façon de mettre en scène nos semblables pour créer un fossé entre nous, et eux. Voilà pourquoi j'ai été interpellé par cet homme. Barnum et son intense volonté de réussir dans les affaires, de divertir grâce à ces « phénomènes », peu importe ce regard collectif, déshumanisant, et ces « monstres » bafoués. Barnum et ce besoin de devenir pionner du progrès des sociétés en pleine révolutions industrielles et questions sur la colonisation. Barnum et ce rôle de concepteur, d'organisateur de spectacles et d'expositions, trompant l'homme lui-même sur l'apogée de son évolution.
Il représente à lui seul, toute une époque.
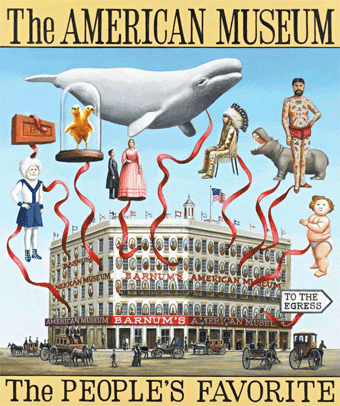

« A la question : quelles sont les qualités requises pour être un bon faiseur de représentations ?
Je répondis que la première qualité nécessaire était une très grande connaissance de la nature humaine, ce qui comprenait bien entendu la faculté d’appliquer judicieusement le savon doux, de plaire au public et de le flatter assez adroitement pour ne pas laisser soupçonner votre attention. »

Mémoires de Barnum, Mes exhibitions.
Si ce n'était qu'une de ces extravagances dont sont capables les Américains.
L'idée de mettre l'autre en scène s'est propagée dans plusieurs pays européens, prenant même l'aspect d'un spectacle zoologique où des populations « exotiques » étaient exposées.

En effet, il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver, au fond d'une malle, les prospectus et slogans publicitaires promouvant cette mode de l'exotisme, théâtralisant grossièrement différentes régions du monde. Ces promesses de dépaysement étaient évidemment fondées sur une imposture. Les figurants se pliaient à une gestuelle surfaite afin d'appuyer les stéréotypes qu'ils représentaient.
Au-delà de la construction de cette représentation plaisant aux foules, le phénomène dissimule surtout la destruction symbolique des populations non-européennes.
Ce concept du "zoo humain" nous vient d'un revendeur d'animaux sauvages, l'allemand Karl Hagenbeck, qui s'inspire grandement de Barnum et de ses mises en scènes d'hommes dotés d'une "certaine singularité". Hagenbeck entreprend ainsi d'exhiber, en 1874, des Samoans et des Lapons dans les villes de Berlin et Leipzig. Présentant leur supposée vie quotidienne dans des villages entièrement reconstitués, il place ces hommes et femmes dans des cages, à côté de celles des animaux. L'idée suscite une réaction immédiate de la société, avide de nouvelles sensations.
Ces villages itinérants ont ainsi su trouver un public dans toute l'Europe, à Paris, Londres et Berlin, mais aussi dans les provinces telles que Nancy ou Lyon en France.
Ces exhibitions, véritable phénomène, sont à l'origine du premier contact d'une grande majorité des Occidentaux avec les populations non-européennes. C'est ainsi qu'au XIXème siècle, on rencontre l'Autre à travers les grilles de son enclos.
Et ça marche.



Karl Hagenbeck
"Antropologisch-Zoologische Ausstellungen"
Le terme "exhibitions anthropozoologiques" naît du passage de l'exhibition individuelle à l'exhibition collective d'êtres humains avec des animaux. Il s'agit d'un pléonasme, puisqu'il est composé de zoo qui renvoie à l’être vivant et anthropo du grec anthrôpos qui signifie l’homme, qui est évidemment lui aussi un être vivant.
...AUX MONSTRES.
En cherchant des exemples de représentants de ces civilisations exhibéEs, j'ai découvert un sujet révélateur de la déshumanisation subie par ces derniers :
Saartje (Sarah) Baartman, de son vrai nom Sawtche.
Extrait du film Vénus noire, Abdellatif Kechiche, 2010.
Cette jeune femme, d'abord esclave, est emmenée jusqu'en Europe où une fois vendue, elle devient bête de foire. La curiosité malsaine qu'elle éveille provient de ses formes hors-normes, notamment ses fesses dites surdimensionnées et de ses organes sexuels protubérants. Elle est ainsi exhibée, de Londres, en 1810, jusqu'à sa mort tragique à Paris, la nuit du 29 décembre 1815.

Sarah incarne un objet de convoitise aux yeux de tous les scientifiques, et ce déjà quelques temps avant son décès : en mars 1805, le professeur de zoologie et administrateur du Muséum national d'histoire naturelle de France, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, fait une requête la concernant. Il demande à examiner « les caractères distinctifs de cette race curieuse », et c'est ainsi qu'elle passe, du public des foires, aux laboratoires où scientifiques et peintres l'étudient. Cette autre forme d'exhibition leur permettra de comparer son visage à celui d'un orang-outang et ses fesses à celles des femmes des singes mandrills, et ainsi à la Vénus d'incarner opportunément le « chaînon manquant » de l'évolution humaine, placée entre les singes et l'Homme.
Mais l'horreur n'a là encore malheureusement pas atteint ses limites. Sa « gloire », tragique et éphémère, n'est qu'un avant-goût de son pathétique destin. En effet, peu après sa mort, le zoologiste et chirurgien de Napoléon Bonaparte, Georges Cuvier, entreprend de disséquer son corps publiquement et en toute illégalité, au nom du progrès des connaissances humaines, afin de prouver l'infériorité de certaines races.
La vie posthume de Sarah commence là, dans un laboratoire, par un moulage complet de son corps. Cuvier prélève, analyse microscopiquement et place dans des bocaux de formol son squelette, son cerveau et ses organes génitaux.
Il publie ensuite en 1817 ses Observations sur le cadavre d'une femme connue à Paris sous le nom de Vénus Hottentote et expose, devant l'Académie de médecine, sa théorie : « Les races à crâne déprimé et comprimé sont condamnées à une éternelle infériorité. ».
Ces travaux sont un précieux témoignage des théories racistes et des préjugés scientifiques qui se divulguent à l'époque, et prouvent combien cette femme, ces hommes et tant d'autres, se sont vus privés de toute leur dignité, réduits à de simples cobayes au service des savants.
Les vestiges de Sarah Baartman, preuves supposées de la supériorité de la « race blanche », resteront exposés jusqu'en 1974 au Musée de l'Homme à Paris.

Après de maintes interventions des colonies sud-africaines, de promesses faites mais oubliées entre Nelson Mandela et François Mitterand, il faudra attendre 2002 et le vote d'une loi spéciale promulguée par Jacques Chirac, pour que sa dépouille puisse enfin rejoindre l'Afrique du Sud et être inhumée selon la coutume de la région où elle était née. Après plusieurs recherches, j'ai pu retrouvé ce texte, qui reconnaît implicitement que le corps de cette jeune femme ait pu appartenir légalement à la République française pendant 212 ans :
Article unique
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les restes de la dépouille mortelle de la personne connue sous le nom de Saartjie Baartman cessent de faire partie des collections de l’établissement public du Muséum national d’histoire naturelle.
L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai de deux mois pour les remettre à la République d’Afrique du Sud.
La « Vénus Hottentote », comme elle était surnommée, était née en 1789, l'année de la Déclaration des Droits de l'Homme en France.
Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaires, contrairement à elle, sont encore ancrés dans la mémoire commune, véritables références du monde scientifique.



Jusqu'à quel point peut-on déshumaniser l'Autre ?
J'en suis venu à faire des recherches sur Elephant Man, l'Homme Eléphant. L'histoire de cet homme, Joseph Merrick, est tout à fait singulière.

Né en Août 1862 en Grande-Bretagne, il présente à partir de ses 21 mois des excroissances, d'abord au niveau de sa bouche, puis au fur et à mesure sur le reste de son corps.
Sa mère expliquait les difformités de son fils par une anecdote farfelue : elle aurait été renversée par un éléphant du cirque alors qu'elle était enceinte. Quand elle meurt, alors que Joseph n'a que 11 ans, son père se remarie, ce qui aura un impact néfaste sur le jeune garçon. En effet, sa belle-mère refuse de reconnaître ce "monstre" comme son fils et à 12 ans, sa scolarité terminée, Merrick est forcé de trouver du travail, chose difficile dans sa condition. C'est finalement son propre père qui va l'expulser de sa maison.
Joseph Merrick vit tout d'abord chez son oncle, puis il entre en 1879 à l'hospice des pauvres, où l'excroissance de sa bouche, en forme de trompe, sera enlevée.
Plus tard, Merrick contacte Sam Torr, responsable du Gaiety Palace of Varieties, afin de s'exhiber en tant que curiosité. L'un des associés peu scrupuleux de Torr, Simon Silcock, spécialisé dans les curiosités humaines et propriétaire d'un cirque, va ainsi emmener Joseph de ville en ville. Il trouve là un public tout aussi horrifié que fasciné par son physique. Ce spectacle étant fort prisé par les étudiants en médecine, le chirurgien Frederick Treves entend ainsi parler d'"Elephant Man", avant d'aller le voir se produire.
Extrait d'Elephant Man, David Lynch, 1980.
Pour cacher son apparence, Merrick décide de porter des chaussons en forme de sac aux pieds. Il met aussi sur sa tête un énorme chapeau et un grand morceau de tissu afin de dissimuler son visage.
Son corps est camouflé sous une ample cape noire.


Treves se trouve fort intéressé par Merrick, dont le destin pathétique le pousse à faire intervenir la police, puisqu'à la même époque, en 1885, les exhibitions d'êtres humains sont interdites en Grande Bretagne. Suite à l'intervention du chirurgien, le "propriétaire" d'Elephant Man quitte l'Angleterre et s'empresse de poursuivre son business, en exhibant "son monstre" en France puis en Belgique.
Toutefois, par un coup du sort appréciable, les autorités de ces pays interdisent à leur tour ce type d'exhibitions. Devenu un "fardeau sans aucune valeur", Joseph Merrick est abandonné dans un train. Néanmoins, l'homme au physique si particulier attire vite l'attention de la police française, qui le ramène en Angleterre, d'où il retrouve la trace de Treves.
Pour la première fois de sa vie, Merrik n'est plus obligé de s'exhiber pour obtenir un toit. En effet, il est installé à l'hôpital de Londres, dont le directeur, Francis C. Carr Gomm, ému par l'existence misérable d'Elephant Man, fait un appel aux dons dans le Times, annonce qui sera relatée par toute la presse. Cette histoire fera grand bruit et des milliers de personnes, dont la reine Victoria, décideront de donner afin d'offrir une fin de vie décente à Merrick. C'est grâce à ce tournant dans sa vie qu'il passera cinq heureuses années dans l'établissement hospitalier, où il recevra de nombreuses visites et pourra se confier, être entendu, non comme une bête mais comme l'homme qu'il était.



"I am not an elephant! I am not an animal! I am a human being! I... am... a man!"
C'est le 11 avril 1890, qu'est mort Joseph Merrick. L'homme s'est éteint dans l'hopital où il résidait, retrouvé dans l'après midi, étendu dans son lit. D'après son médecin, il serait probablement mort d'étouffement. En effet, son énorme tête était très lourde, forçant Merrick à dormir la tête en avant. Le fait qu'il ait été retrouvé couché pose une véritable question: accident ou suicide ? L'homme était conscient des risques de cette position, aurait-il choisi de mourir étendu, et den dormir, pour la première fois, comme un homme bien constitué ? Ou est-ce juste une erreur qui s'est avérée fatale ?